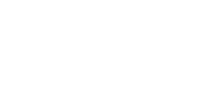La classe de 1ère HLP a eu la chance de découvrir un roman historique, « Vénus en révolution » sur la guerre des paysans au XVIème siècle. Par la suite, c’est avec honneur que nous avons accueilli l’auteur Paul Abel au CDI du lycée. Sans même qu’il commence à parler, on pouvait sentir que cet homme avait beaucoup de choses à raconter. Cela s’est d’ailleurs confirmé puisque ses premières paroles témoignaient de sa gratitude à l’égard de cette rencontre. En effet, cet auteur a expliqué n’avoir jamais échangé avec des lycéens de cette manière. Une grande joie enthousiasmante pouvait ainsi se lire sur son visage. De notre côté, nous avions déjà assisté aux interviews d’auteur dans le cadre du prix Goncourt des lycéens ainsi qu’un artiste, Lamine Diagne, à propos du spectacle, « Le Livre Muet ».
La première partie des questions à Paul Abel concernait donc son roman « Vénus en Révolution », paru en 2014. Il a avoué s’être inspiré de beaucoup d’auteurs différents en citant Louis-Ferdinand Céline, plutôt sombre et cruel, ou encore l’égyptien Naguib Mahouz, mais surtout Marguerite Yourcenar. Il souhaitait qu’on retienne particulièrement ce nom puisqu’il évoquait sa très grande admiration pour cette écrivaine française. Cette dernière avait publié en 1951 un ouvrage intitulé « Les Mémoires d’Hadrien » basé sur le principe d’une narration venant d’un personnage ayant atteint le sommet de la société, un empereur romain au Ier siècle après J.C. Paul Abel a donc expliqué avoir repris cette idée de personnage âgé qui retrace sa propre existence en choisissant plutôt un membre standard du peuple ainsi qu’un évènement très peu raconté, la guerre des paysans. En effet, l’envie d’écrire de Paul Abel s’est manifestée par le désir de trouver quelque chose d’assez rare dans la littérature. Ainsi, nous avons compris qu’il s’agissait d’un passionné de lecture romanesque et historique.
En outre, Paul Abel est un membre de la société d’histoire et d’archéologie de Saverne. Son travail de romancier consiste donc à allier l’histoire, qui doit être ordonnée selon les sources, ainsi que l’écriture dans laquelle une liberté infinie est possible. Malgré cela, l’auteur considère que la vérité historique n’existe pas non plus, puisque les faits dépendent de la façon dont ils sont transmis. Il insiste également sur l’aspect des émotions que l’on ne trouve que dans les romans, la musique, ainsi que la poésie.
L’écrivain nous a également fait part de ses convictions spécifiques sur le métier de romancier. Selon lui, ce dernier doit oser présenter une œuvre à un éditeur. Il s’agit d’un travail personnel, chaque être humain étant unique comme sa proposition de livre. L’écriture en elle-même possède une infinité de mystères puisqu’elle dépend des pensées de son auteur qui ne sont semblables à aucunes autres. Paul Abel explique qu’il inventait par exemple des personnages du roman à cause d’une chose qu’il avait aperçue au cours de sa journée. De la même manière, ses relectures restaient une énigme puisqu’il affirmait jeter parfois les deux tiers de sa production de la veille. Cela permet de réaliser que les quatre ans consacrés à « Vénus en Révolution » étaient probablement très riches en écriture, mais qu’une grande partie a été finalement modifiée.
Dans l’écriture de son roman, il avait envie d’un personnage qui se pose des questions sur la liberté, l’art et l’amour. Si cette idée était une évidence, le titre « Vénus en Révolution » l’était moins. Il a finalement opté pour une référence au tableau avec « Vénus » et à l’Histoire avec « Révolution » pour évoquer l’art de la Renaissance mais il a toujours eu le sentiment qu’il pouvait trouver mieux. Son roman a été édité au temps des premiers livres numériques, il avait voulu rendre celui-ci interactif avec de la musique, des images et du texte en pop-up, mais cela n’a pas été possible car il y avait trop de difficulté et cela coûtait trop cher. Ainsi, son frère François, illustrateur de BD, lui a proposé d’illustrer son histoire. L’auteur très attaché à la culture alsacienne, a souhaité donner une couleur locale à son roman français en incluant des mots alsaciens à son histoire, mais aussi afin de pouvoir créer une distance historique. Enfin, le héros du roman s’avère être un peintre qui a croqué des scènes de cette révolution au cœur de l’action.
Paul Abel, l’historien
Nous avons ensuite assisté à une conférence sur la guerre des paysans dirigée par Paul Abel et « sa casquette d’historien ».
La guerre des paysans de 1525 est un événement majeur de l’histoire du Saint-Empire romain germanique, marquant un soulèvement populaire avec des répercussions particulièrement fortes en Alsace et en Lorraine. Ce conflit, souvent étudié dans les ouvrages de Paul Abel comme « Venus en Révolution » et « Paysans en Guerre », fait encore l'objet de commémorations aujourd’hui, notamment par l'Association « 1525, une révolution oubliée ».
Au début du XVIe siècle, l’Empire était un ensemble hétérogène dirigé par Charles Quint, avec une Alsace et une Lorraine sous son autorité. Trois évolutions majeures avaient transformé la période : les découvertes géographiques, l’imprimerie et l’humanisme. L’imprimerie, notamment, bouscule l'autorité de l'Église en démocratisant l’accès au savoir. Ces changements, associés aux tensions religieuses croissantes, préfigurent la révolte.
Les premières révoltes, sous le nom de « Bundschuh », ont émergé dès 1493, dénonçant les abus des seigneurs et du clergé. Ces soulèvements se sont intensifiés jusqu’en 1517, alimentés par la diffusion des idées de Luther, qui contestait l’autorité papale. En 1524, le « Bundschuh » renaît et la révolte se radicalise, avec des attaques contre les églises et des exactions envers les autorités.
En 1525, la révolte s’intensifie, et le 12 mai, les paysans arrivent à Saverne, ville symbolique de l’autorité ecclésiastique. En réponse, le duc de Lorraine mobilise ses troupes. Le 16 mai, une bataille sanglante a lieu près de Lupstein, où les insurgés sont écrasés. Le 17 mai, la répression atteint son paroxysme : Saverne est prise d’assaut, la ville est pillée, et de nombreuses vies sont perdues, bien que les estimations varient de 6 000 à 18 000 morts.
La répression qui suit fait 60 exécutions supplémentaires, dont 12 prêtres, et impose un contrôle sévère sur la région. Cet événement historique, bien que méconnu, révèle les fractures sociales profondes entre les paysans et les élites. Il annonce des mouvements populaires futurs, comme la Révolution française.
En mai 2025, l'Association « 1525, une révolution oubliée » organisera des commémorations à Saverne et aux environs pour marquer les 500 ans de la révolte, rappelant un moment crucial où l’oppression a engendré un soulèvement qui résonne encore aujourd’hui. Un spectacle chapeauté par le Comité des Fêtes de Saverne et mis en scène par Paul Schirck retracera ces affrontements en juillet à l’Espace Rohan de Saverne.
Eline Callegher et Nadia Morin